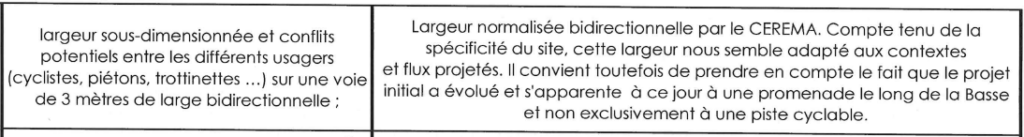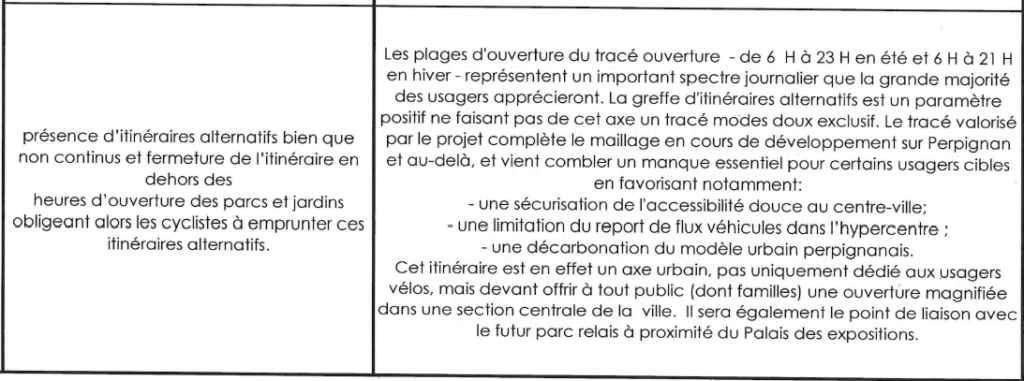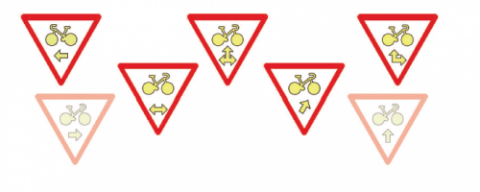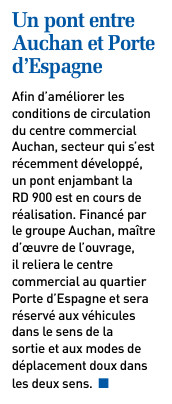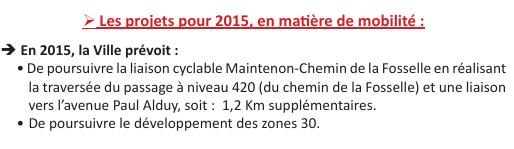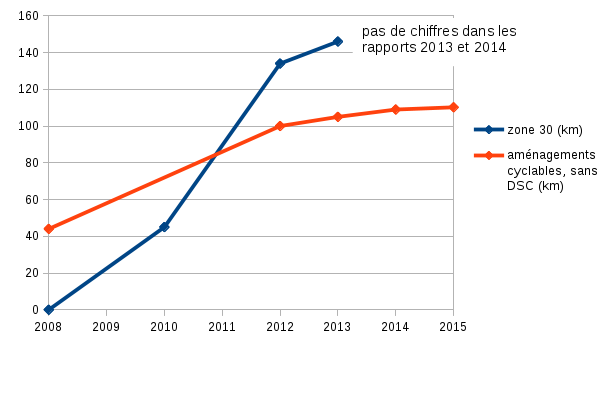Alors que la préfecture des Pyrénées-Orientales vient de délivrer l’autorisation environnementale pour ce projet ce jeudi 22 janvier, nous en profitons pour mettre en ligne l’avis que nous avions publié sur la PPVE (participation du public par voie électronique), consultation publique réalisée par la Ville de Perpignan. On trouve en bas de page toutes les contributions dont la notre (pages 35 à 38). Nous vous la retranscrivons ici car elle contient aussi notre contre-proposition à ce projet, qui ne nous semble pas pertinent pour les usagers que nous représentons :
L’association Vélo en Têt reste sur la position qui est la sienne depuis l’apparition du projet en début de mandat : préférer un cheminement en surface, plus efficace pour la desserte et l’accessibilité, plus lisible pour les déplacements du quotidien et beaucoup moins coûteux pour la collectivité. Pour plus de détails, lire notre article du 24 janvier 2021 : https://veloentet.fr/article/basse-pour-un-projet-100-cyclable
Pour répondre plus précisément à cette consultation ; en tant que représentante des usagers du vélo dans le département, l’association n’est pas favorable à ce nouveau projet intitulé à tort « CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE SUR LES BERGES DE LA BASSE ARTIFICIALISÉES DANS LA TRAVERSÉE DE PERPIGNAN ». Nous rappelons que le terme « piste cyclable » a une définition légale bien précise dans le code de la route : « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ».
Le cheminement proposé sur les berges étant partagé entre les piétons (et assimilés) et les cycles, il ne peut pas être considéré comme une « piste cyclable ».
Un axe cyclable, qui plus est structurant, se doit de proposer une voie en site propre, c’est à dire dédiée aux cycles. En l’état, le projet ne nous semble pas pertinent ou du moins pas prioritaire dans le schéma directeur des mobilités actives.
Si l’on considère l’aspect purement cyclable, l’intérêt risque d’être limité pour les déplacements du quotidien.
En effet, des liaisons (plus ou moins bonnes) existent déjà pour rallier la Têt depuis le centre-ville à vélo :
– Direction le Vernet ou St Estève, il est plus direct de rester sur les quais pour aller attraper le pont Joffre via la rue Payra.
– Pour aller vers le Polygone, Bompas etc., il est plus pratique de prendre le Cours Palmarole, la rue Claude Bernard puis le pont Beltrame et enfin le chemin du Mas Donat.
Autre point noir : le cheminement sera fermé la nuit (mieux dit : il suivra les horaires des parcs et jardins de la ville), ce qui va bloquer les cyclistes le matin et le soir. C’est déjà problématique plus en amont avec l’aire de jeux des jardins de la Basse qui accueille en son sein un tronçon de la voie verte en rive gauche, fermé avant 9h toute l’année et après 17h30 en automne et hiver.
Dernier point et non des moindres : la cohabitation entre les deux modes de déplacement (marche et vélo) est toujours compliquée, voire dangereuse, comme nous le constatons sur le quai Vauban… Elle sera d’autant plus problématique dans cet espace confiné de 2/3 mètres de large, dans la mesure où les deux cheminements ne seront pas séparés.
Comme précédemment, notre contre-proposition ci-dessous se veut pragmatique et économique : améliorer l’existant en proposant un itinéraire cyclable dédié et continu en surface.
L’objectif de la mairie étant de raccorder le pôle d’activité de Saint Charles à la Têt, nous proposons de suivre cet itinéraire étape par étape pour en détailler les améliorations possibles. Nous le décomposerons en quatre tronçons :
- Av. Panchot ➡️ Av. JL Torreilles
Même si ce segment est perfectible, l’aménagement cyclable est plutôt réussi, notamment la belle piste cyclable longeant l’av. d’Athènes.
N.B : le passage sous la voie de chemin de fer (chemin de la Paille) mériterait d’être amélioré, ainsi que la traversée de l’av. Torreilles, qui est assez incompréhensible pour les cyclistes. Un simple jalonnement à des points clés permettrait d’améliorer la lisibilité des itinéraires sur ce secteur, tant sur l’axe est-ouest que sur l’axe nord-sud.
2. Av. JL Torreilles ➡️ Av. Ribère
L’ouverture d’une voie verte débouchant sur le parking Quinta en rive droite en 2021 a permis de résoudre un point noir important sur ce segment. Précédemment, le franchissement de la passerelle était obligatoire… et parfois bloquant a cause du dispositif anti-scooters sur la rive gauche, sans parler de la problématique de la traversée du parc suivant l’heure de la journée (voir plus haut).
Même si la discontinuité a ete résolue, ce tronçon en rive droite reste un espace partagé avec donc une presence continue de piétons et de chiens, sur ce qui est plus un itinéraire de promenade qu’une voie destinée au vélotaf…
P.S : comme souvent, le franchissement des intersections (ici l’av. Ribere) est bâclé, alors qu’il s’agit des points où les cyclistes ont le plus de risques d’accident. D’autant plus qu’il faut une nouvelle fois changer de rive pour profiter d’une meilleure expérience cyclable. Nous passons donc en rive gauche sur le quai de Hanovre.
3. Av. Rivière ➡️ Cours Escarguel
Vélo En Têt remercie les services de la mairie d’avoir suivi ses préconisations (voir notre article sus-cité) sur ce tronçon, mais considère que le résultat est très inégal.
Si le quai de Hanovre suit les standards d’un bon aménagement cyclable, le traitement des intersections est (encore) vraiment problématique. On peut citer la liaison avec le quai Nobel, qui est tout simplement incompréhensible et dangereuse. Au passage on peut questionner la pertinence stratégique et financière d’installer un totem de comptage à cet emplacement…
Sur le quai Nobel, le cheminement cyclable est un trottoir partagé avec les piétons, qui se retrouvent coincés dans une espace restreint ne respectant aucune norme (rappel 1m40 minimum), entre la balustrade et les platanes. Par confort, nombre d’entre eux empruntent donc la piste cyclable. Malgré les pictogrammes au sol, les conflits d’usage sont fréquents.
N.B : une fois n’est pas coutume, la piste cyclable s’interrompt brutalement à 50 mètres du Cours Escarguel et il faut donc s’insérer dans le flux automobile ou poursuivre sur l’étroit trottoir…
4. Square Jeantet-Violet ➡️ Têt
Sur le square l’espace est (encore) partagé avec les piétons. Une piste cyclable matérialisée par de la peinture au sol (y compris pour la traversée) permettrait de diminuer les conflits d’usage.
On arrive sur le quai Bourdan qui est à sens unique (est->ouest), sans piste cyclable dédiée ni même de double-sens cyclable matérialisé.
Plus bas, la mairie a prévu de longue date l’installation d’une rampe permettant de descendre du pont de Guerre sur le haut du quai Vauban, encore accessible aux véhicules motorisés mais qui devrait devenir prochainement piéton en accueillant une piste cyclable que nous espérons à la hauteur des exigences actuelles.
Après le Palmarium, il serait important de réfléchir à la meilleure manière de passer le quai Vauban à vélo pour accéder à la piste cyclable de la rue Payra au nord et au Cours Palmarole vers l’est. Prévoir un cheminement spécifique sur Vauban semble compliqué vu la fréquentation piétonne et les nombreux commerces avec terrasses, il ne reste donc que le quai Sadi Carnot, qui devrait justement être prochainement libéré des véhicules motorisés (sauf bus et véhicules autorisés).
Afin d’éviter les stationnements sauvages sur cet axe, il nous paraît important de prévoir des places réservées pour les véhicules de travaux et de livraison, bien que le recours à la cyclologistique nous semble incontournable pour tout l’hyper-centre…
Une fois au pont Larminat, nous devrons changer de rive pour la quatrième fois afin de rejoindre la piste cyclable bidirectionnelle du pont Joffre et enfin descendre à la Têt.
Pour cela, deux options sont possibles :
A) Par le quai Vauban devant les Galeries Lafayette (mais là encore l’espace est limité), puis la récente piste cyclable bidirectionnelle de la rue Payra.
B) Par la place de la Victoire puis le quai Battlo en prévoyant un itinéraire cyclable dédié, sécurisé et continu.
Ici, une connexion serait à prévoir avec le cours Palmarole vers les quartiers Est/Nord.
Dans tous les cas, le franchissement de l’axe Wilson-Clémenceau méritera une réflexion approfondie, que nous espérons ouverte aux usagers que nous représentons…
Comme expliqué plus haut, la connexion avec la Têt existe déjà via l’avenue Torcatis au niveau du pont Joffre. Pour la continuité vers le Polygone Nord ou Bompas, il ne manquerait qu’à créer une piste cyclable sur le Cours Palmarole ou les allées Maillol puis sur la rue des Coquelicots.
Les bénévoles de Vélo en Têt se tiennent disponibles pour faire découvrir cet itinéraire aux cyclistes, journalistes, technicien·nes, décideurs/ses politiques, etc. qui voudraient en savoir plus sur cet axe structurant, ses points forts, ses faiblesses et ses pistes d’amélioration.
Le collège de Vélo en Têt
Nous notons au passage que les porteur·ses du projet ont répondu (de manière plus ou moins honnête) aux points remontés par les participant·es : rapport PPVE (pages 12 à 17).
NDLR : à gauche la/les problématique(s) soulevée(s), à droite la réponse apportée